Grèves et luttes sociales : enjeux et actualités ici et ailleurs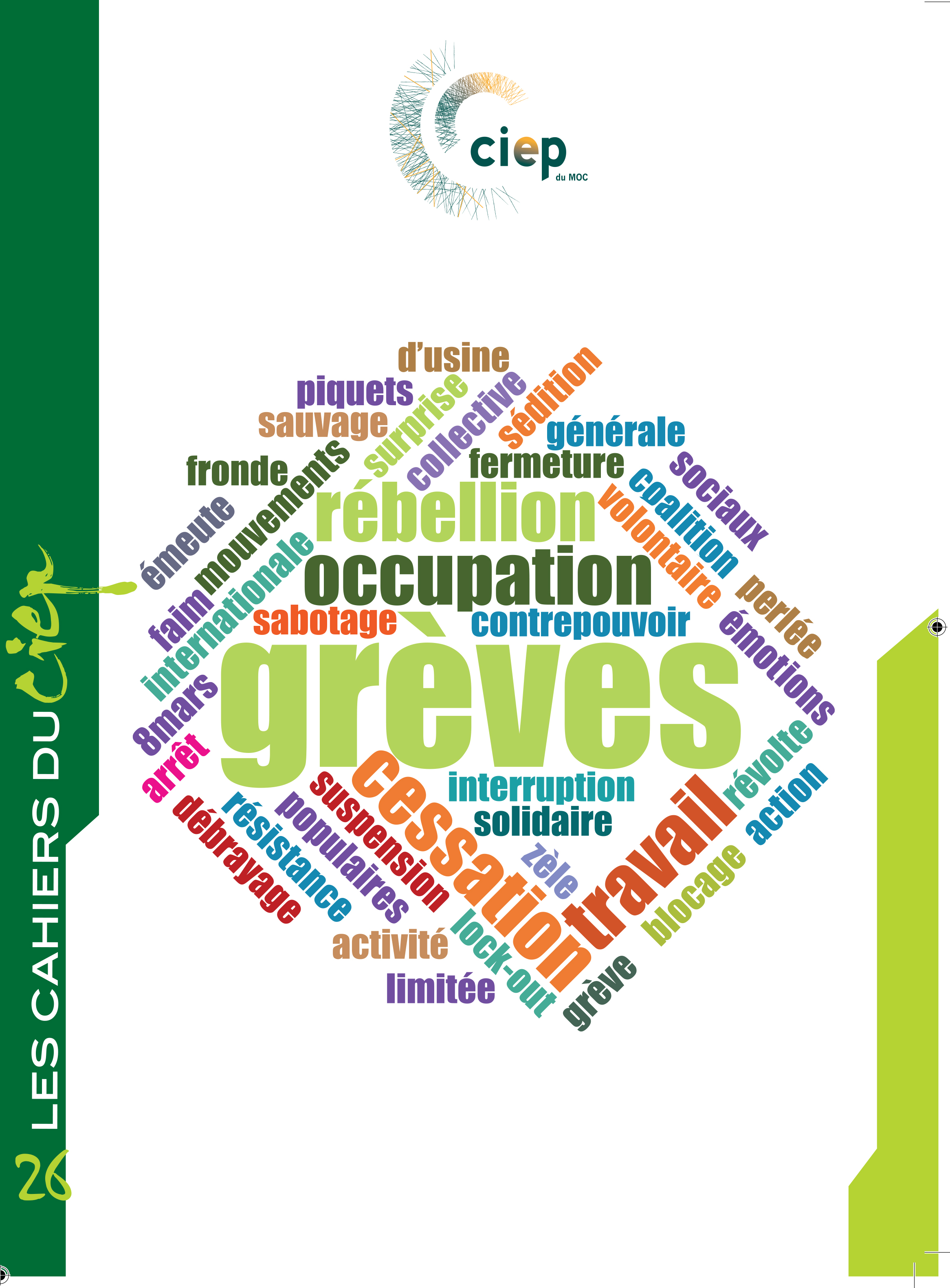
Quel est le sens d’une étude à propos de la grève en 2019 ? Depuis 2016 (début des mouvements de grève des femmes), on observe une sorte de renaissance, de redécouverte de la grève comme forme d’action collective. Les acteur.rice.s collectif.ve.s qui y ont recours aujourd’hui sont – en partie – différent.e.s des acteur.rice.s historiques qui l’ont pratiquée avec un certain succès pendant presque deux siècles. Et, d’autre part, cette renaissance va à contre-courant de l’image négative qui s’est construite autour de la grève ces quarante dernières années. La grève « de classe » a perdu son élan en partie à cause d’une perte d’efficacité et en partie à cause de la prévalence de l’attention sur les effets de dérangement qu’une grève doit provoquer pour être efficace sur le sentiment de solidarité avec les travailleur.euse.s en lutte.
Les grèves dans le secteur des services sont devenues difficiles à porter car la lutte contre l’employeur.euse/patron.ne est prise en otage par la mise en avant de la souffrance provoquée aux usager.ère.s. En cela les médias font, depuis des décennies, un travail systématique d’effacement des raisons des travailleur.euse.s et de spectacularisation des plaintes des usager.ère.s. Et même au-delà de la représentation médiatique de la grève, on sait, par exemple, à quel point il est difficile pour certaines catégories de travailleur.euse.s – notamment le personnel des structures de soins – de mener des actions de grève sous le chantage posé par les autorités et les employeur.euse.s que la lutte empêcherait les soins aux patient.e.s.
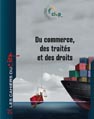 Du commerce, des traités et des droits
Du commerce, des traités et des droits
(Publié en 2019)
 Agis t'es du local !
Agis t'es du local !
Actes de la journée d'étude du CIEP du 02 mars 2018
(Publié en 2018)
